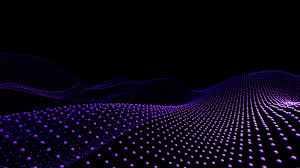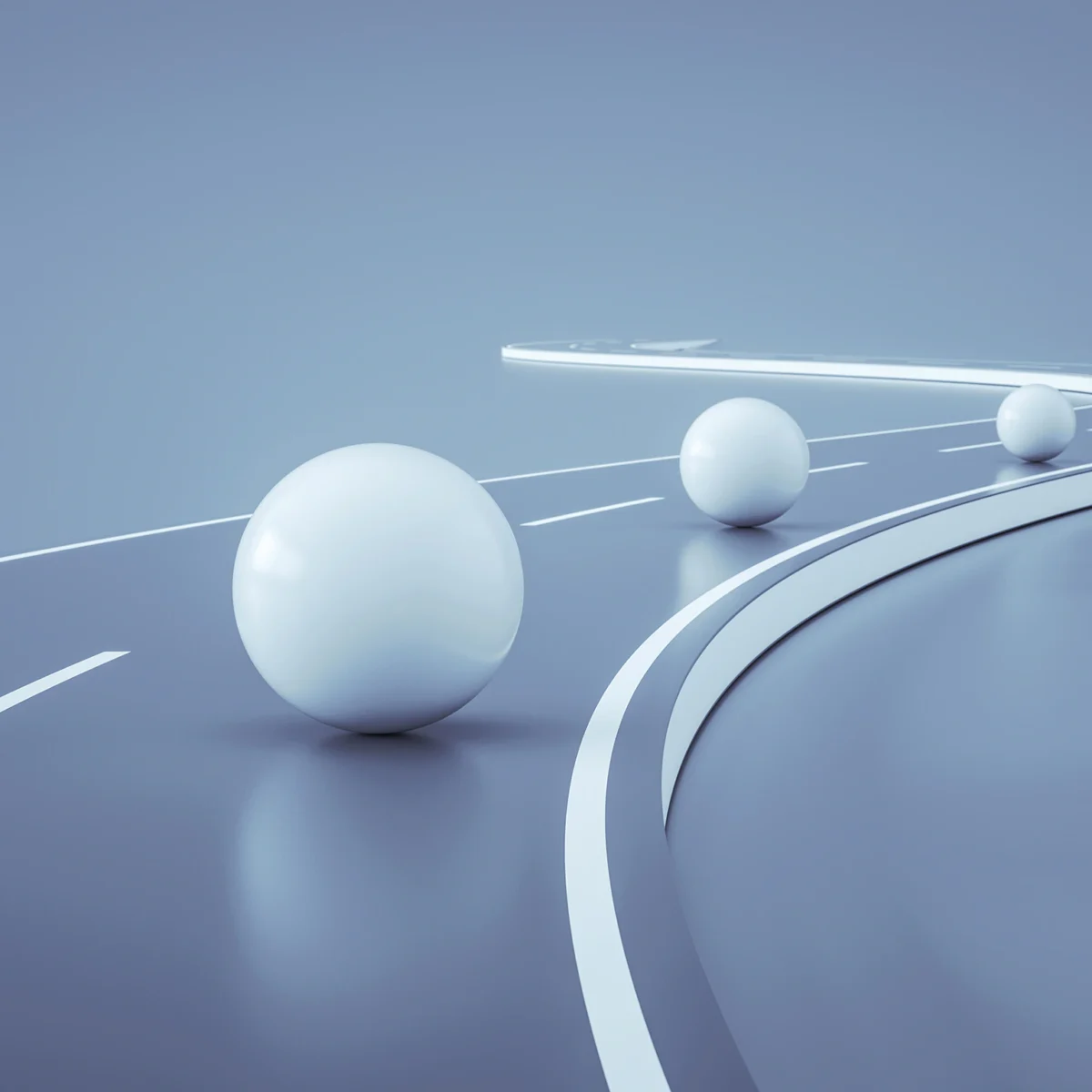Dans un environnement applicatif moderne, la fonctionnalité de recherche n’est plus un simple “nice to have” mais un véritable levier business. Derrière les trois solutions open source les plus populaires – Apache Solr, Elasticsearch et OpenSearch – se cache le même moteur : Apache Lucene. Leur capacité à traiter le full-text, à proposer un classement par pertinence et à supporter des requêtes complexes constitue la base de 80 % des cas d’usage standards.
Au-delà de ces fondamentaux communs, le choix se joue sur l’architecture, la gouvernance, la licence et l’écosystème. Cet article compare en profondeur ces moteurs afin de guider les DSI, CIO et chefs de projet IT dans leur décision stratégique.
Ce qu’ils ont en commun
Ces trois moteurs partagent le même socle Lucene et offrent des fonctionnalités full-text avancées. Pour la plupart des cas d’usage, leur performance et leur pertinence sont équivalentes.
Recherche full-text et classement de pertinence
Chaque moteur s’appuie sur Apache Lucene pour indexer et interroger du texte (voir notre article sur bases de données NoSQL). Les algorithmes de scoring intégrés évaluent la fréquence des termes, leur rareté et leur impact sur la pertinence globale des résultats. Cette sophistication garantit une expérience utilisateur fluide quel que soit le volume de données.
Le ranking multicritère permet d’ajuster finement le poids des champs et d’incorporer des facteurs métier dans le calcul. Les filtres dynamiques, tels que le faceting, complètent l’approche en offrant un filtrage post-requête rapide et intuitif. Les requêtes de proximité, les wildcards et le highlighting font partie intégrante du cœur du moteur.
Les opérations de tri multi-champs restent instantanées même sur des index de plusieurs centaines de millions de documents. Les optimisations par segments et la compression des index offrent un équilibre qualitatif entre vitesse de recherche et taille de stockage. Pour 80 % des besoins courants, aucun des trois ne se distingue significativement de ses concurrents.
Un acteur e-commerce utilise ce socle pour proposer des suggestions en temps réel et constater une hausse de la conversion de plus de 12 %.
Flexibilité des requêtes et filtres dynamiques
Les trois moteurs acceptent des requêtes complexes combinant full-text et filtrage structuré. On peut enchaîner des clauses booléennes, des agrégations et des projections sur des champs numériques ou géospatiaux. L’utilisateur final bénéficie d’une recherche avancée sans sacrifier la performance.
Les facettes et agrégations dynamiques génèrent des counts et des métriques sans requête supplémentaire. Cette capacité est essentielle pour les dashboards métiers et les interfaces B2B. Consultez notre guide du data pipeline pour optimiser ces processus.
Les champs multi-values et multi-types sont pris en charge nativement, ce qui permet de stocker des attributs multiples sous un même nom logique. L’ajout d’un champ comportemental, par exemple, ne nécessite pas de migration lourde. Cette souplesse accélère les cycles de release et diminue les risques de régression.
Une institution publique a exploité ces filtres dynamiques pour cibler des rapports par région et par période en quelques millisecondes. Cette mise en œuvre a mis en lumière l’importance d’un mapping adéquat plutôt que la supériorité intrinsèque d’un moteur sur un autre.
Écosystèmes et intégrations open source
Solr, Elasticsearch et OpenSearch bénéficient de connecteurs vers les stacks log analytiques, BI et plateformes de monitoring. Que l’on utilise Kafka, Logstash, Fluentd ou NiFi, l’ingestion reste fluide. Les API RESTful ou gRPC offrent également des intégrations sur mesure pour des besoins très spécifiques.
Les plugins et extensions enrichissent la plateforme avec des composants de sécurité, d’authentification ou de routing. On retrouve des modules open source pour l’auth LDAP, l’OIDC ou la gestion fine des ACL. Cette modularité hérite directement de la philosophie du libre.
Le déploiement s’effectue via des containers Docker ou des chartes Helm, garantissant une portabilité cloud-native. Les templates d’index sont paramétrables et versionnables, favorisant une approche GitOps. L’infrastructure as code renforce la cohérence entre les environnements de dev, de test et de production.
Facteur clé : licence et gouvernance
Le passage d’Elasticsearch à la licence SSPL a redessiné la carte de l’écosystème open source. OpenSearch apparaît comme une alternative Apache 2.0, écartant le risque de verrouillage.
Évolution d’Elasticsearch et SSPL
Jusqu’à la version 7.10.2, Elasticsearch était sous licence Apache 2.0, offrant une liberté totale de distribution et de service managé. À partir de cette version, la bascule vers la SSPL rend le code non conforme aux critères OSI. Toute offre managée doit publier son code source de l’ensemble de la plateforme.
Cette exigence a complexifié l’adoption chez des prestataires qui ne souhaitent pas exposer leur couche d’orchestration. Les DSI craignent un audit de licence et une remise en question des services existants. Les contrats cloud deviennent plus lourds et demandent un examen juridique poussé.
Le pivot stratégique d’Elastic a entraîné un risque de fragmentation de la communauté et une réévaluation des partenariats. Certains fournisseurs d’APM et de logging exclusifs à Elasticsearch ont revu leur feuille de route pour ajouter des déclinaisons OpenSearch. L’écosystème s’est scindé en deux branches parfois incompatibles.
OpenSearch sous licence Apache 2.0
Forké par Amazon en 2021, OpenSearch reprend Elasticsearch 7.10.2 et Kibana sous licence Apache 2.0. Cette démarche garantit l’absence de contraintes sur le déploiement managé. Les développeurs peuvent intégrer et distribuer librement le code sans clause de réciprocité.
La communauté OpenSearch s’est rapidement structurée autour d’un consortium d’acteurs open source. Des réunions mensuelles définissent les priorités, des RFC sont discutées publiquement et un tracker d’incidents est accessible à tous. L’orientation reste clairement tournée vers la transparence.
Les modules de sécurité, de reporting et d’alerting ont été réécrits pour garantir la compatibilité avec la licence Apache. Cette réécriture a pris plusieurs mois, mais elle assure une continuité fonctionnelle pour les utilisateurs n’ayant pas migré leurs clusters.
{CTA_BANNER_BLOG_POST}
Implications pour les services managés
La licence SSPL empêche les prestataires de proposer Elasticsearch en mode SaaS sans ouvrir l’ensemble de leur code. Les offres managées basées sur SSPL nécessitent donc un audit précis et des SLA adaptés. Pour aller plus loin, découvrez notre article sur la gestion appropriée du risque cyber.
En revanche, OpenSearch permet une création d’offre managée sans contrainte juridique. Les intégrateurs peuvent personnaliser leur stack, proposer des fonctions additionnelles et garantir une roadmap indépendante. Le maintien d’une licence Apache favorise un modèle de service plus flexible.
Les DSI doivent aligner leur choix de moteur avec leur politique interne de conformité et de gestion des fournisseurs. Les entreprises fortement régulées, notamment dans la finance et la santé, privilégieront OpenSearch pour éviter toute ambiguïté sur les droits d’usage.
Solr vs Elasticsearch : architecture et scalabilité
Solr et Elasticsearch diffèrent surtout par leur approche du schéma et de la distribution. Le premier impose un mapping strict, le second favorise l’agilité et le cloud-native.
Schéma et modélisation des données
Apache Solr repose sur un schéma XML ou JSON prédéfini. Chaque champ doit être déclaré avant ingestion, ce qui offre un contrôle fort sur le type, les analyzers et les copyFields. Cette rigueur réduit les erreurs implicites et facilite les revues de mapping lors de migrations de systèmes legacy.
Elasticsearch adopte un modèle schema-free avec mapping dynamique. Les nouveaux champs sont détectés automatiquement lors de l’indexation. Cette flexibilité accélère le prototypage et l’expérimentation, mais peut générer des mappings inattendus sans garde-fous.
Le schéma strict de Solr permet de documenter chaque composant d’index et d’intégrer des validations métiers en amont. Les équipes DSI apprécient cette transparence pour gérer les évolutions à long terme et les régressions potentielles.
Langage de requête et intégration applicative
Solr propose un langage de requête riche, basé sur Lucene Query Syntax, permettant de composer des requêtes booléennes, de span, ou de join entre collections. Cette expressivité répond aux besoins de recherche très fines, notamment dans le domaine juridique ou documentaire.
Elasticsearch mise sur une API RESTful avec un DSL JSON. La syntaxe est plus intuitive pour les développeurs web et facilite l’intégration dans des pipelines CI/CD. Les requêtes peuvent être construites dynamiquement depuis n’importe quel client HTTP.
La documentation d’Elasticsearch est souvent jugée plus accessible grâce à des exemples en JSON et des bibliothèques officielles en Java, Python, Node.js et Go. Les développeurs front-end gagnent ainsi en autonomie pour prototyper.
Scalabilité et orchestration cloud
Elasticsearch est conçu dès l’origine pour le cloud-native, avec sharding et rééquilibrage automatique. Les nœuds peuvent rejoindre ou quitter le cluster sans interruption de service et la réplication entre datacenters assure une haute disponibilité.
SolrCloud propose également du sharding et de la réplication, mais requiert un réglage manuel du path des collections et du routing. L’orchestration sur Kubernetes passe par ZooKeeper, ce qui ajoute une couche de complexité à gérer.
Le scaling horizontal d’Elasticsearch est généralement plus fluide grâce à des APIs de réallocation de shards. Les opérations de rolling upgrade s’effectuent sans effort supplémentaire, ce qui réduit la fenêtre de maintenance.
Une entreprise de logistique a évalué SolrCloud et Elasticsearch. Elle a constaté que la mise à l’échelle d’Elasticsearch offrait une meilleure résilience en cas de pic de trafic, confirmant son positionnement cloud-native.
Elasticsearch vs OpenSearch : fonctionnalités et roadmap
Bien qu’issus du même code, Elasticsearch et OpenSearch évoluent désormais sur des voies distinctes. L’un met l’accent sur des services managés et des features propriétaires, l’autre sur l’ouverture et la communauté.
Fonctionnalités propriétaires et alternatives open source
Certains modules d’Elasticsearch, comme le security plugin avancé, l’alerting et la gestion fine des index, sont désormais distribués sous licence propriétaire. Les utilisateurs doivent souscrire à des abonnements Elastic pour y accéder.
OpenSearch a réimplémenté ces fonctionnalités en versions open source sous Apache 2.0. La suite comprend le security plugin, les dashboards de visualisation et un moteur d’alerting natif. Les équipes peuvent ainsi bénéficier de toutes ces briques sans coût additionnel.
Le fork a engendré un effort considérable pour maintenir la compatibilité API tout en garantissant la liberté de modification. Les contributeurs d’OpenSearch publient régulièrement des releases synchronisées et un changelog transparent.
Évolutions et cas d’usage émergents
Elasticsearch intègre désormais les Data Streams pour le traitement natif des time series et l’analyse en continu. Cette capacité cible les use cases de monitoring, d’IoT et de logs de performance.
OpenSearch a introduit la segment replication pour accélérer la réplication entre clusters et réduire les délais de récupération en cas de défaillance. Cette innovation renforce la résilience sur des architectures distribuées géographiquement.
Les roadmaps divergent progressivement : Elasticsearch oriente ses efforts vers des services managés et des modules ML propriétaires, tandis qu’OpenSearch privilégie les contributions externes et les plugins communautaires.
Communautés et support
Elasticsearch conserve la plus grande communauté, avec un volume élevé de questions sur les forums et un écosystème riche en plugins tiers. Les certifications Elastic et la documentation payante constituent un avantage pour des utilisateurs prêts à investir.
La communauté OpenSearch grandit rapidement, portée par des contributions d’éditeurs et d’intégrateurs. Les projets s’organisent autour d’un GitHub centralisé et d’un Slack ouvert à tous. Le support commercial est proposé par plusieurs intégrateurs spécialisés.
Les mises à jour de sécurité et les correctifs critiques sont publiés en parallèle sur les deux plateformes, mais le cycle de release d’OpenSearch reste légèrement plus lent afin de garantir une validation communautaire plus large.
Choisir votre moteur de recherche
Le choix entre Solr, Elasticsearch et OpenSearch ne se réduit pas à un comparatif technique. Il repose sur la licence, la gouvernance, votre expertise interne, et les objectifs métiers prioritaires. Solr brille par sa rigueur de schéma et son modèle mature, Elasticsearch par son agilité cloud-native et son écosystème dominant, et OpenSearch par son engagement Apache 2.0 et son évolution communautaire.
Quel que soit votre secteur – e-commerce, SaaS, media ou observabilité – l’expérience interne et les enjeux stratégiques guideront votre décision. Nos experts sont à votre disposition pour analyser votre contexte, comparer l’impact des licences, et définir la meilleure feuille de route pour implémenter ou migrer votre moteur de recherche.